Si vous n’avez jamais assisté à un cours du Collège de France ni à plus forte raison à une leçon inaugurale, il faut savoir qu’il s’agit d’une tradition qui remonte au seizième siècle (1530). Fidèle à sa devise « Docet omnia » (il enseigne toutes choses), ce vénérable institut du savoir a une particularité, c’est qu’on y enseigne le savoir « en train de se faire », c’est-à-dire la recherche scientifique en elle-même.
A l’occasion de la création de la chaire de psychologie cognitive expérimentale, le professeur Stanislas Dehaene fait son premier cours : sa leçon inaugurale. C’était le 27 avril 2006. Publié chez Fayard au prix de 10€, c’est un ouvrage que je conseille à tous ceux qui veulent avoir un aperçu de l’état des recherches dans cette discipline. Je suis depuis de nombreuses années les travaux de cette chaire mais je n’avais jamais regardé les ouvrages écrits par le professeur Dehaene. C’est chose faite.

« Guillaume, c’est pas un blog sur les Sciences de l’Information et de la Communication ? » Ne rigolez pas, on m’a posé la question avant que je publie. Du coup je réponds. Comment peut-on se dire étudiant ou chercheur en SIC, sans s’intéresser au point nodal qui filtre, trie, évalue toutes les informations qui circulent dans nos sociétés : le cerveau ?
Je retiendrai de cette leçon inaugurale que « notre système nerveux apprend à comprendre son environnement, c’est-à-dire à le prendre en lui, à l’internaliser sous forme de représentations mentales qui reproduisent, par isomorphisme psychophysique, certaines de ses lois. Nous portons en nous, un univers d’objets mentaux dont les lois imitent celles de la physique et de la géométrie. » p.28
A propos de la chronométrie mentale de la décision, on peut lire des positions surprenantes. Par exemple, pour l’auteur, il ne fait aucun doute que l’invention d’algorithmes symboliques a décuplé les compétences mathématiques humaines, et pourtant, il affirme que leur fondement reste profondément enraciné dans la cognition animale. Cela s’explique en fait par les expérimentations au début des années 2000 de l’activation d’une région dite de « calcul » dans le lobe pariétal, étudiée notamment chez le singe macaque, d’où l’homologie entre les primates humains et non-humains. (p.44)

Pour faire simple, le système de décision doit « dans un environnement neuronal bruité, repéré et extraire le signal pertinent »… sélectionner l’information.
Vous comprenez mieux pourquoi, cher lecteur en SIC, je t’invite à lire cette leçon inaugurale. Cette marche aléatoire est même capable de prédire la latence de réponse et même la survenue des erreurs… prédictibilité quand tu nous tiens.
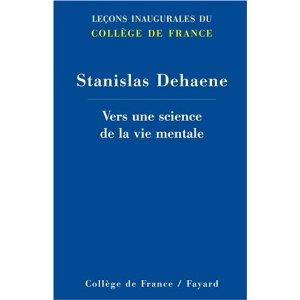
Juste pour dire que il y a une faute de frappe « s’en s’intéresser » devrait être probablement substitué par « sans s’intéresser ».
Merci pour la coquille